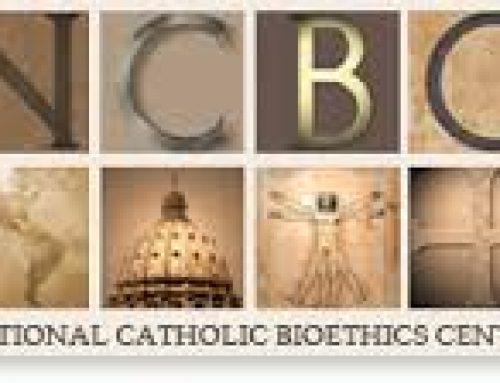http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/notre-regard-sur-la-fin-de-vie-17903.html
Bioéthique – 22 janvier 2014
Notre regard sur la fin de vie
En lien avec la déclaration du Conseil permanent du 16 janvier 2014, le Conseil Famille et Société a publié le 17 janvier 2014, une réflexion sur la fin de vie. Ce texte, beaucoup plus long, cherche à faire saisir la complexité des questions que soulève la fin de vie et à aider les catholiques, particulièrement celles et ceux actifs dans le domaine de la santé, à entrer en dialogue avec leurs contemporains sur ce sujet sensible.
Organisme qui reçoit délégation de l’Assemblée plénière des évêques.
La question de l’euthanasie revient avec une certaine régularité dans le débat public. Nous y sommes tous sensibles parce que concernés à un moment ou un autre de notre existence, mais plus particulièrement les soignants, les proches des personnes en fin de vie et celles et ceux qui sont engagés dans la pastorale de la Santé, dans les Aumôneries des hôpitaux ou dans la pastorale des personnes handicapées. Accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches, est une expérience qui fait naître beaucoup de questions. Dans des situations concrètes de grande souffrance, la position de l’Eglise catholique, qui refuse l’euthanasie et l’assistance au suicide, demande à être fondée et éclairée pour être reçue et expliquée à d’autres.
Dans cette perspective, en lien avec la déclaration du Conseil permanent du 16 janvier 2014, la note du Conseil Famille et Société souhaite partager quelques réflexions avec ceux et celles qui sont confrontés à ces situations de fin de vie et avec les acteurs catholiques dans le champ de la santé, souvent en situation de dialogue et de débat sur ces questions importantes. Se fondant sur ce que les chrétiens reçoivent de la Révélation en Jésus-Christ, ce document veut donc aussi prendre appui sur le terrain de la raison. En amont et indépendamment de tout projet législatif, le texte vise à faire saisir la complexité de l’accompagnement de la fin de vie où il s’agit à la fois d’entendre les souffrances individuelles et collectives qui s’expriment, de mesurer la difficulté à affronter la mort et la souffrance, et de rappeler le devoir impératif d’accompagner toute vie humaine. Ce faisant le Conseil Famille et Société poursuit sa contribution pour aider les chrétiens à entrer en dialogue avec leurs contemporains sur des sujets de société difficiles. C’est leur vocation d’être toujours prêts à « rendre compte de l’espérance qui les habite », et à le faire « avec douceur et respect ». (1 Pierre 3, 15-16)
Après la loi du 22 avril 2005 révisant la législation relative aux droits des malades et à la fin de vie, on pouvait penser avoir atteint un sage équilibre mettant à l’abri pour l’avenir des dérives émotionnelles et des manipulations partisanes. La loi du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », venait encadrer la fin de vie et les droits du malade.
Les grands principes de la loi Leonetti peuvent être résumés de la façon suivante :
1. Demeure l’interdit fondamental de donner délibérément la mort.
2. Elle énonce l’interdiction de l’acharnement thérapeutique, c’est-à-dire l’obstination déraisonnable (L. 1110-5 CSP alinéa 2) d’administrer des actes « inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. »
3. Le respect de la volonté du patient s’il est en état d’exprimer sa volonté doit être respectée pour apprécier le caractère « déraisonnable » de certains actes médicaux. Sinon, c’est le médecin qui prend la décision, après avoir recherché quelle pouvait être la volonté du patient (existence de directives anticipées, consultation de la personne de confiance, de la famille), et avoir respecté une procédure collégiale.
4. La loi fait obligation au médecin de soulager la douleur, de respecter la dignité du patient et d’accompagner ses proches. Quand les traitements curatifs cessent, la loi demande qu’on dispense les soins palliatifs.
5. La protection des différents acteurs est assurée par la traçabilité des procédures suivie.
Au-delà des clivages politiques, elle avait été votée à l’unanimité, aussi bien à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat. Cette loi condamne donc l’obstination déraisonnable, encadre la limitation et l’arrêt des traitements, favorise les soins palliatifs et cherche à mieux prendre en considération la volonté de la personne malade. Elle accepte qu’un traitement destiné à soulager la douleur puisse avoir comme effet secondaire d’abréger la vie du malade, mais elle maintient l’interdiction de tout acte visant directement à provoquer la mort.
Or, trois ans plus tard déjà, lorsque la commission parlementaire d’évaluation de la loi, dirigée à nouveau par M. Leonetti, rend son rapport de plus de 300 pages le 28 novembre 2008, la question du choix de la mort resurgit : certains jugent les conclusions de la commission trop immobilistes. De fait, la question de l’euthanasie continue à interroger notre société à travers la présentation médiatique récurrente – et souvent tronquée – de certains cas tragiques, singuliers et très douloureux. A chaque fois, la gravité de la situation et la souffrance de la personne suscitent une émotion collective, souvent sciemment orchestrée, qui semble ne pouvoir se traduire que par une nouvelle demande de légalisation de l’euthanasie.
Ainsi, en 2012, des sondages font état de la volonté croissante d’une grande majorité des sondés de pouvoir demander que le médecin les aide à mourir en cas de situation de fin de vie jugée insupportable [1]. Depuis l’introduction de la question de l’euthanasie dans le débat public par le Manifeste de trois prix Nobel le 1er juillet 1974 [2], des propositions de lois sont régulièrement déposées par des députés ou des sénateurs qui souhaitent une évolution de la législation française. Dans les pays qui ont légalisé ou dépénalisé l’euthanasie, comme la Belgique, il serait illusoire de croire que le débat est clos : au contraire, les demandes de réformes législatives se poursuivent jusqu’à envisager l’euthanasie pour les mineurs ou les personnes handicapées. Les citoyens se trouvent ainsi placés en état d’insatisfaction permanente devant les lois, même les plus soigneusement élaborées, car celles-ci se révèlent incapables de régler toutes les situations qui se présentent.
Ce constat invite à prendre la mesure des questions que soulève la médicalisation actuelle de la fin de vie. Il y a tout d’abord des difficultés humaines pour lesquelles aucune loi ne peut apporter de solution. Il s’agit ensuite d’évaluer quelques arguments avancés par les partisans de l’euthanasie et de l’assistance au suicide au regard de la complexité des situations de fin de vie.
1. Reconnaître l’importance et les limites de la loi
La question de la fin de vie est complexe et fait apparaître de graves divergences de vues sur le sens de la vie elle-même. Certains considèrent que le médecin respecte la dignité du patient en fin de vie lorsqu’il lui administre une injection létale ; d’autres pensent que le respect de la dignité de la personne passe par la mise en œuvre de soins palliatifs. Dans cette diversité d’approches, se jouent les choix éthiques déchirants entre la responsabilité sociale du corps médical et la demande de la personne en fin de vie. Des divergences profondes apparaissent dans la façon de considérer la personne dans sa dignité et ses droits.
Divergences d’autant plus insurmontables que la question de la fin de vie touche l’émotion de chacun devant la souffrance, – la sienne ou celle de l’autre -, face à l’épreuve de la dégradation physique et le sentiment de ne pouvoir rien faire. Une émotion qui vient parfois perturber le jugement éthique.
Aujourd’hui, les fins de vie sont de plus en plus médicalisées et solitaires et, selon les sondages, l’engagement religieux ne semble pas fondamental pour dessiner la frontière entre les partisans de l’assistance au suicide et ses opposants [3]. Comme chrétiens, vivant dans une culture qui refuse de reconnaître la mort et la souffrance comme parties intégrantes de la vie humaine, nous partageons bien les interrogations qui surgissent face à une fin de vie jugée interminable. Nous nous retrouvons en communion avec les femmes et les hommes qui, ne partageant pas notre foi, sont confrontés aux mêmes grandes questions
de l’existence humaine, et manifestent le même souci de respecter la vie, de sa conception jusqu’à la mort naturelle.
Nous croyons que la foi chrétienne est porteuse d’une vision de l’homme et d’un sens de l’existence qui peuvent être partagés avec d’autres. L’expérience suscitée par la foi contribue à révéler le sens de ce qu’est vivre, souffrir et mourir. C’est à partir de là que nous pouvons mieux cerner ce qui peut être demandé à la loi et ce qui relève d’autres registres.
1.1 Difficultés nouvelles pour penser la mort aujourd’hui
Penser la mort est une difficulté contemporaine. Certes, cette difficulté n’est pas nouvelle puisqu’elle était déjà abordée par les philosophes stoïciens, mais elle a tendance à s’intensifier dans un monde en pleine mutation et dans une société de plus en plus sécularisée qui a du mal à accepter la finitude naturelle. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette difficulté croissante.
Il y a d’abord l’impossibilité individuelle de se représenter « sa » mort. Freud soutenait à cet égard que « la mort propre est irreprésentable et aussi souvent que nous en faisons la tentative, nous pouvons remarquer qu’à vrai dire nous continuons à être là en tant que spectateur ». D’où l’idée que personne ne croit à sa propre mort, et que « dans l’inconscient chacun de nous est convaincu de son immortalité [4]. » Le déni de la mort est ainsi lié à l’irreprésentable de sa propre mort, mais aussi à l’angoisse devant la perte du proche. Le sujet occidental aurait d’autant plus tendance à se protéger de l’idée de la mort, que le confort de la vie contemporaine s’accommode mal de la radicalité de la perte. Le fait qu’il n’y a plus rien à faire et que la séparation est définitive, nous renvoie à nos limites et à notre finitude, d’où une difficulté à faire face à la mort.
Il y a ensuite la disparition des rites sociaux du deuil. La ritualité collective autour de la mort s’est effacée de la cité : il n’y a plus de veillée autour du mourant, plus de signes extérieurs pour les personnes en deuil, plus de représentation collective de la mort banale, avec, au contraire, une intensité émotionnelle et médiatique très significative autour des morts brutales. Notre société recherche de nouveaux rites face à la mort comme, par exemple, celui du rassemblement et de la marche blanche. Cependant, ce sont davantage des exutoires de l’émotion collective et de l’indignation qu’une prise en charge de la confrontation à la mort. S’il soutenait l’irreprésentabilité de la mort de l’inconscient, Freud exhortait cependant à faire à la mort la place qu’elle devrait avoir dans nos pensées conscientes. Une préparation à la mort est nécessaire pour sortir de l’illusion d’y échapper. C’est un enjeu essentiel de l’accompagnement en fin de vie de la personne malade et de ses proches.
La pensée de la mort, et plus précisément l’élaboration d’outils psychiques et de valeurs communes concernant l’affrontement de chacun à sa propre mort, est en déficit. La pauvreté rituelle des cérémonies de funérailles pour ceux qui n’ont pas de références religieuses en est une illustration. En parallèle, les travaux des psychologues sur le cheminement subjectif du deuil sont nombreux, et s’affirme davantage aujourd’hui le vœu de mettre en place un accompagnement personnalisé des personnes en deuil. C’est en soi positif, mais cette privatisation du deuil, corrélative de l’absence de rites sociaux du deuil, ne facilite pas l’élaboration d’une pensée collective de la mort. La revendication d’euthanasie et d’assistance médicale au suicide intervient dans ce contexte d’une privatisation de la mort et d’un affrontement très autarcique de chacun à sa propre mort. Cet affrontement semble accusé par le fait qu’aujourd’hui 58 % des personnes décèdent dans un établissement de santé, loin de leurs proches. Mais est-ce qu’une loi peut aider à mieux penser la mort et à réinventer des rites sociaux de deuil ?
1.2 Maintenir les relations jusqu’au bout
La solitude devant la mort est source d’angoisse. La solitude des mourants est, selon l’expression du sociologue Norbert Elias, un des signes majeurs de la « froideur culturelle occidentale ». Froideur des fins de vie médicalisées où la technicité peut se révéler « sans âme » [5]. Froideur des fins de vie vécues dans l’isolement quand la structure familiale fragilisée et éclatée ne peut plus prendre en charge les malades, les handicapés et les personnes âgées. Notre société individualiste a du mal à imaginer la manière d’être présent dans ces derniers moments de la vie, souvent expulsés de la cité. S’il n’existe pas nécessairement une manière de bien mourir, le vrai respect de la dignité humaine exige de mourir en sachant qu’on demeure relié aux autres. Une partie des demandes d’euthanasie pourrait s’inscrire dans cette peur – qui n’est pas dénuée de fondements – de ne pas demeurer jusqu’au bout relié au monde des vivants. L’intitulé du Rapport de la Commission de réflexion sur la fin de vie dirigée par le Professeur Didier Sicard et présenté au Président de la République le 18 décembre 2012, Penser solidairement la fin de vie, est à ce titre indicateur de ce souci.
L’homme est un être relationnel. Chaque être humain naît d’une relation et se construit en tant que personne à travers les relations qu’il tisse avec d’autres. L’interdépendance est constitutive de l’être humain. L’autonomie et la liberté n’existent pas en faisant abstraction des autres mais uniquement dans une relation ajustée aux autres. La dépendance d’un nouveau-né fragile et vulnérable ne pose de problèmes à personne. En revanche, la dépendance d’une personne âgée est souvent perçue comme dégradante. Cela provient, notamment, de l’idéal totalitaire de la santé du corps qui prévaut dans notre société et qui plonge dans l’exclusion tous celles et ceux qui ne participent pas de cet idéal de la perfection physique et de l’éternelle jeunesse. Combattre cette exclusion passe par une mise en cause de ce diktat, solidement ancré dans l’imaginaire collectif et quotidiennement entretenu par les publicités. Il s’agit de faire valoir la priorité de la relation avec la personne.
Pour le chrétien, quand bien même la personne serait atteinte d’une maladie ou d’un handicap altérant ses capacités cognitives et relationnelles, il ne serait pas possible de la déclarer « morte socialement ». La foi chrétienne nourrit la conviction que la valeur de la personne n’est pas attachée à son utilité ni à une liste de qualités physiques, intellectuelles qui lui permettent d’entrer en relation. Mais ce n’est pas là une conviction particulière aux chrétiens ; ces mêmes principes fondent la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ainsi que la déontologie médicale. Les uns et les autres, nous attestons une fraternité en humanité qui demeure, y compris en fin de vie, lorsqu’une personne est entièrement remise entre les mains d’autrui. Face à cette situation, les chrétiens sont appelés à faire mémoire de Jésus, crucifié hors de la ville (Jean 19, 20), comme s’il était mis au ban des relations humaines et qui, ressuscité des morts, devient le contemporain de chaque être humain. Nul désormais n’est plus seul, même au moment de sa mort. Le Christ est à ses côtés. Les chrétiens se reconnaissent requis de manifester concrètement la proximité du Seigneur par leur présence fraternelle auprès de la personne en fin de vie. Ils attestent ainsi qu’elle demeure, jusqu’au bout, membre de notre humanité sauvée, et accompagnée par Celui qui nous fait passer dans la Vie en Dieu.
Accompagner la fin de vie implique alors d’accueillir la dépendance physique et psychique comme inhérente à notre condition humaine. Cette dépendance heurte notre vision idéalisée de l’homme, mais elle ne fait pas obstacle à la relation, même si elle peut l’altérer. Les soins palliatifs ont justement pour objectif de ré-institutionnaliser la relation en fin de vie, et d’offrir une présence humaine aimante et apaisante dans les derniers moments. Que peut faire une loi pour maintenir la relation entre les personnes ?
1.3 Entendre et situer les souffrances
La demande actuelle d’un droit de hâter la mort et de bénéficier de l’assistance au suicide se fait entendre à différents niveaux. Il faut distinguer la demande sociale ou collective et la demande concrète d’une personne en fin de vie.
Une demande sociale d’en terminer avec la souffrance
La demande présente dans les sondages, souvent orchestrée, est une revendication sociale dont l’un des arguments principaux tient au sentiment d’impuissance et de révolte devant les douleurs mal soulagées de certaines fins de vie. Les concepts d’euthanasie ou d’assistance au suicide servent à exprimer le geste d’abréger volontairement et directement la vie quand celle-ci est jugée intolérable ou inutile. La question de la fin de vie devient le révélateur d’une société qui n’arrive plus à se situer devant la souffrance.
La médecine contemporaine offre une gamme de traitements sophistiqués pour soulager cette douleur tout en reconnaissant que certains analgésiques puissants peuvent raccourcir la vie du patient et supprimer sa conscience. Déjà, en 1957, le pape Pie XII déclarait à des médecins qui lui demandaient si l’on pouvait, en fin de vie, utiliser des narcotiques qui risquaient d’abréger la vie : « S’il n’existe pas d’autres moyens et si, dans les circonstances données, cela n’empêche pas l’accomplissement d’autres devoirs religieux et moraux : oui.» Dans le même esprit, la loi Leonetti permet d’utiliser toutes les ressources de la médecine pour soulager la douleur de la personne en fin de vie, même lorsque l’emploi de telles substances peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie. Mais, comme le reconnait le dernier rapport Sicard de décembre 2012, il est vrai que le « maniement concret » de ces traitements antidouleur « laisse à désirer » et que tous les français ne sont pas égaux devant
le traitement de la douleur en fin de vie [6]. Ce rapport appelle avec justesse à mettre en œuvre une véritable justice sociale dans le domaine de l’accès aux soins palliatifs. Il invite à ne pas séparer curatif et palliatif, à proposer des « soins de support » à toutes les étapes.
Ainsi, le projet des soins palliatifs s’inscrirait dans une globale « culture du soin » dans laquelle la mission des acteurs pastoraux trouve sa place avec les autres accompagnants qui entourent la personne.
La demande d’un sujet ou de son entourage
Beaucoup de personnes en fin de vie affirment que leurs souffrances ne sont pas contrôlées, qu’elles ne participent pas aux décisions médicales qui les concernent et se sentent ainsi abandonnées. La supplication d’en finir est alors celle d’une personne singulière à un moment donné de son histoire où elle se prononce sur une qualité de vie et sur le sens d’une existence.
Cette révolte devant la douleur de la personne en fin de vie, concerne aussi le groupe qui accompagne l’agonisant. Il suffit d’écouter ceux qui accompagnent des personnes très proches dans leur agonie pour percevoir l’intensité douloureuse du partage émotionnel, de l’affrontement au délabrement corporel et à la demande affective, parfois importante, du mourant. La souffrance en jeu dans les demandes d’euthanasie n’est donc pas seulement la douleur du mourant. Elle doit être resituée dans un jeu de relations où le sujet en fin de vie affecte ceux qui l’entourent.
La demande d’euthanasie est alors à contextualiser. Ainsi, si certaines demandes viennent effectivement des personnes elles-mêmes, d’autres viennent explicitement des proches du patient. Il existe souvent une interaction complexe entre la personne, sa famille, et le personnel soignant. Souvent les soignants ressentent que se jouent des sentiments contradictoires dans les échanges avec les personnes malades et leurs familles. Dans ces périodes douloureuses de fin de vie, les équipes soignantes se sentent souvent seules, affrontées aux limites de l’hyper-technicité de la prise en charge et à la forte pression d’une médecine qui pourrait tout. Les soignants ont besoin d’être soutenus dans les décisions qu’ils ont à prendre pour accompagner la fin de vie. Dans les cas où le sujet est encore conscient, qu’en est-il de sa propre perception du poids des attentes, de la lassitude et des problèmes de son entourage ? Exprimer le désir d’en finir est parfois le symptôme de la souffrance de tout un groupe dont la personne en fin de vie se fait porteuse.
Quelles que puissent être les évolutions législatives, aucune loi ne pourra lever nos appréhensions devant la mort ou instituer des rites sociaux pour affronter le deuil. Elle ne viendra pas apaiser notre angoisse devant la solitude ou nous dire comment maintenir les liens avec ceux qui sont en fin de vie. Elle ne pourra pas davantage supprimer nos souffrances lors de la maladie ou la perte d’un être cher. Il faut donc sortir de l’illusion qu’une loi, une solution technique simple, puisse régler la complexité de la vie. Aujourd’hui, en interdisant l’acharnement thérapeutique, parlant à ce propos d’obstination déraisonnable, la loi Leonetti garantit la liberté pour les soignants d’imaginer des réponses adéquates aux situations de souffrance, souvent favorisées par la solitude. Toutefois, autant il est nécessaire de souligner les limites des solutions que la loi peut apporter, autant il est légitime d’examiner et d’évaluer les arguments avancés par ceux qui militent en faveur d’une légalisation de l’euthanasie ou de l’assistance au suicide.
2. Peser les arguments présents dans le débat
Dans les arguments exprimés en faveur de l’euthanasie ou de l’assistance au suicide revient fréquemment le suivant : si la société s’autorise à prolonger la vie grâce aux interventions d’une médecine de pointe, pourquoi n’aurait-elle pas le pouvoir de hâter la mort ? On considère alors que le geste technique de hâter la mort serait le mode inversé de la culture et de la logique de l’acharnement thérapeutique qui révèle une médecine incapable de reconnaître la mort comme inhérente à la vie humaine.
2.1 Les objectifs de la médecine
On comprend alors pourquoi l’euthanasie et l’assistance au suicide se parent des couleurs de la compassion face à une médecine qui affirme servir la qualité de la vie mais resterait impassible face aux douleurs trop fortes et aux corps gravement altérés.
Face à cette situation, des questions ne manquent pas de surgir dans l’opinion publique. Le propre de la médecine moderne qui reconnaît l’autonomie du malade n’est-il pas de répondre aux besoins du patient ? Pourquoi, dans un contexte où les objectifs de la médecine sont définis en fonction des exigences de l’autonomie du patient, s’opposer à la demande d’un malade en fin de vie ? Face à ces questions, on saisit que mettre un terme à la vie des hommes et femmes en fin de vie n’est « qu’une réponse partielle et partiale à un problème de fond, celui de l’objectif de la médecine à l’égard des personnes en fin de vie. [7]»
Or, il convient de s’entendre sur les objectifs de la médecine au sein de la société. Si on envisageait de hâter la mort d’un patient en fin de vie, ce serait un professionnel de santé qui poserait le geste et en porterait la responsabilité. Son geste ne serait pas privé mais public, au sein d’une société qui délimiterait le consentement éclairé du patient et la déontologie du corps médical. En demandant à la loi d’autoriser l’euthanasie ou l’assistance au suicide, on demanderait à la collectivité d’acquiescer à la mort de la personne en fin de vie et de conférer aux soignants le pouvoir de donner la mort. Cela n’est pas neutre.
Le pouvoir de donner la mort entre en conflit avec le devoir universel de soins et d’accompagnement de la médecine. La mort d’une personne, parce qu’elle vit en relation avec les autres, affecte aussi le corps social. La loi, votée au nom du peuple français, deviendrait l’expression d’un nouveau contrat social admettant que certains ont droit de donner la mort pour répondre à des raisons d’ordre personnel et que certaines vies ne vaudraient plus la peine d’être vécues. La loi viendrait à la fois remettre en cause la déontologie médicale (art. 38 : « [Le médecin] n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort »), l’engagement solidaire des soignants, le contrat social défendant la valeur de toute personne quel que soit son état, et l’ambition politique du soin des personnes vulnérables.
2.2 Un respect de la conscience et de la liberté
Un autre argument en faveur de l’euthanasie présente celle-ci comme relevant de la liberté et de l’autonomie d’une personne qui fait son choix en toute lucidité, et hors de toute influence. Cette décision se réclame d’une conscience éclairée qui s’opposerait aux vieux tabous judéo-chrétiens du refus de l’euthanasie. Nous sommes en droit de nous interroger pour savoir si, dans les circonstances données, la conscience n’est pas émoussée par la souffrance. Car, bien souvent, la demande d’un patient d’en finir avec la vie intervient dans le contexte d’une douleur estimée insupportable. Il arrive aussi qu’elle soit suscitée par le refus d’une dégradation corporelle ressentie comme une perte de dignité. Les proches eux- mêmes sont épuisés, en ces fins de vie qui s’éternisent parfois en raison des progrès médicaux : ils peinent à endurer jusqu’au bout la souffrance de ceux qu’ils aiment. Si la loi laissait apparaître l’euthanasie et l’assistance au suicide comme une possibilité d’épargner à la famille la charge de leur proche, elle renforcerait chez cette personne le sentiment de rejet social et le désir de mourir, affectant ainsi sa liberté.
Il s’agit donc d’analyser ce qu’il en est de la liberté des plus fragiles. Face à une décision de vivre ou de mourir, ceux qui peinent à porter leur vie et se trouvent seuls sont parfois conduits à croire que la seule possibilité serait d’en finir. Une décision de liberté peut-elle se satisfaire de l’absence de réelle alternative ? Que dire par ailleurs, de ceux qui, en difficulté psychique voire en situation de pathologie mentale, sont affectés de pathologie de la liberté et de la décision ? Comment évaluer surtout la plus ou moins grande privation de liberté de celui qui demande l’euthanasie ? Ne faut-il pas plutôt chercher, dans une démarche de solidarité, à éclairer la liberté de choix de la personne – au niveau du choix des soins, de l’accompagnement, de la sédation de la douleur – que de lui octroyer rapidement, à la « demande », une solution technique rendue nécessaire par un contexte appauvri en possibilités ? L’euthanasie serait alors plus l’expression d’une situation sans issue que d’une liberté qui se détermine en fonction d’une alternative dont les termes seraient équilibrés. La liberté de pouvoir demander l’euthanasie contredit ce qu’est fondamentalement la liberté.
2.3 Un respect de la dignité
L’argument le plus employé pour revendiquer la légalisation de l’euthanasie et de l’assistance médicale au suicide est celui du respect de la dignité humaine. Les associations qui militent pour cela depuis une quarantaine d’années, disent le faire au nom d’une « mort digne » alors que les initiateurs des soins palliatifs revendiquent aussi le respect de la dignité de la personne en fin de vie. C’est dire que si tous sont d’accord pour reconnaître que toute personne humaine mérite le respect, la façon de l’honorer est plurielle dans le cas des grands souffrants en fin de vie. Deux normes de comportements opposées pourraient ainsi être légitimées dans notre société pluraliste au nom du respect de la dignité de la personne : l’euthanasie et les soins palliatifs. On comprend le désarroi de nos contemporains troublés par ce pluralisme de comportements tributaire d’anthropologies différentes passées sous silence dans l’accord tacite autour de la valeur de la dignité humaine. C’est donc que la dignité humaine ne signifie pas la même chose pour tous. On comprend aussi, à partir de là, comment dans les sondages, les croyances qui fondent les anthropologies peuvent apparaître des facteurs secondaires puisque leur lien avec une conduite régulée, visible et consensuelle s’affaiblit.
Or, si on ne peut plus présupposer que, dans notre société, nous partageons une unique vision de la dignité de l’homme, il nous faut comme chrétiens approfondir et témoigner comment notre foi au Christ vient nous ouvrir à une conception de l’humain qui détermine une manière singulière d’aborder la question de la dignité humaine. Elle est attachée à la condition de l’homme comme créature, qui dans sa nudité, son dénuement, y compris en Celui qui « n’avait plus figure humaine, et son apparence n’était plus celle d’un homme » (Isaïe 52, 14), demeure pourtant humain dans son rapport constitutif à Dieu Son Père et à ses frères en humanité. En celui qui n’a pas encore accédé au langage ou celui qui l’a perdu, en celui dont la liberté est entravée ou diminuée par une cause psychique ou physiologique, tout homme est invité à reconnaître malgré tout un frère en humanité qui doit être respecté sans condition.
Il y a quelque chose d’extrême dans une telle attestation de la dignité humaine. C’est la portée de la parabole du jugement dernier (Evangile selon Saint Matthieu, chapitre 25) et du visage du crucifié. C’est dans la foi et les sacrements que nous percevons l’énigme de la valeur de tout être humain, véritable icône du Christ. Quand c’est possible, pour ceux qui se réfèrent à la foi chrétienne, la prière partagée, la célébration d’un sacrement (communion eucharistique, pardon, sacrement des malades) surtout lorsqu’ils associent des membres de la famille, des proches, peuvent être des moments intenses et apaisants pour tous à l’approche de la fin de vie. C’est la foi qui, par la conversion, peut nous aider à inventer les pratiques du respect de la dignité des plus vulnérables de notre société. Le témoignage des chrétiens et la façon dont ils approchent la personne en fin de vie, qu’ils soient membres de la famille, soignants ou agents pastoraux, est ici essentiel. Leurs motivations se conjuguent
avec celles des humanistes qui se réfèrent à l’impératif moral de Kant : « Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans toute autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen [8]. » Réclamer l’assistance au suicide impliquerait autrui dans une décision pour soi-même. La liberté de l’autre serait ainsi directement impliquée dans une solidarité pour la mort et non dans une solidarité pour le soin. Honorer la dignité absolue de la personne humaine est un appel à prendre soin de la dignité de l’autre, à créer les conditions de dignité de la fin de vie. A-t-on assez remarqué que l’invention des soins palliatifs a mûri sur ce terreau ?
En conclusion : le devoir d’accompagner les plus vulnérables
Respecter l’être le plus vulnérable, ne pas faire peser sur lui un sentiment de culpabilité d’être encore-là malgré le prix des soins, se rendre présent à l’autre abandonné, se vouloir frère en humanité, faire tout pour soulager les souffrances de la fin de vie, telles sont des attitudes qui appartiennent à notre tradition et qui nous amènent à pousser plus loin le questionnement sur la solution que représenterait l’assistance au suicide. L’expérience des soins palliatifs est éclairante. Par-delà le contrôle de la douleur, ils remettent au sein d’un réseau de véritable compassion la personne qui vivait l’abandon ou l’humiliation de sa condition et permettent à la vie de mûrir quand la fin se fait toute proche. L’expérience du mourir se trouve ainsi intégrée comme moment sensé de l’existence qui demeure inscrite jusqu’au bout dans un lien social, en solidarité avec des compagnons d’humanité. Légiférer sur la fin de vie nécessite de sauvegarder cette ambition politique de solidarité.
C’est pourquoi, nous devons sortir de l’idée, permettant d’évacuer sans doute notre propre angoisse de mort, d’une réponse technique à un problème « à résoudre ». Une loi n’évitera pas – le contraire serait dramatique pour la condition humaine – le débat moral du personnel soignant, ou la souffrance des proches. La confrontation à la mort est, dans tous les cas, une souffrance, pour le patient bien sûr, mais aussi pour les accompagnants. Nous devons ainsi tenter de regarder en face une vérité douloureuse : quelles que soient les mesures prises pour hâter la mort ou pour soulager l’agonie, nous ne pourrons évacuer la souffrance du mourir, qui n’est pas seulement constituée de la douleur du corps mais aussi de ce travail de deuil de soi et de la relation à autrui que nous aurons tous à vivre.
Cette souffrance du mourir, le christianisme ne la nie pas, mais il pense qu’elle peut être affrontée avec d’autres dans le cadre d’une conception de l’être humain comme fondamentalement en relation, et dont la dignité demeure inaliénable. Cette vision de l’homme s’enracine pour les chrétiens dans le changement de perspective que la mort et la résurrection du Christ ont apporté au sens même de la mort humaine. La constitution pastorale Gaudium et spes l’atteste : « C’est donc par le Christ et dans le Christ que s’éclaire l’énigme de la douleur et de la mort qui, hors de son Evangile, nous écrase » (22, 6). Cependant, cette approche peut faire sens pour d’autres. Les chrétiens la défendent dans le débat actuel sur la fin de la vie parce qu’ils pensent qu’elle peut apporter une aide réelle à ceux qui souffrent et à une société qui a du mal à envisager la fin de vie comme un fait concernant au premier chef la solidarité humaine avec tous.
Cela rejoint la conclusion du rapport Sicard qui souligne « qu’il serait illusoire de penser que l’avenir de l’humanité se résume à l’affirmation sans limite d’une liberté individuelle, en oubliant que la personne humaine ne vit et ne s’invente que reliée à autrui et dépendante d’autrui. Un véritable accompagnement de fin de vie ne prend son sens que dans le cadre d’une société solidaire qui ne se substitue pas à la personne mais lui témoigne écoute et respect au terme de son existence ».
C’est également en ce sens que le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, a exprimé ce souhait : « avant de légiférer encore, qu’on se demande si ce serait pour donner un signe plus grand du respect de la personne humaine, d’une solidarité avec elle ou bien plutôt celui d’un nouvel affaissement de nos solidarités familiales et sociales, exigeantes parfois, porteuses de fruits toujours. »[ 9]
Pour le Conseil Famille et Société [10], le 17 janvier 2014, Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, président.
Evêque placé à la tête d’une province ecclésiastique.Service d’Église qui assure une présence chrétienne dans un ensemble.Ensemble des évêques de France.Organisme qui reçoit délégation de l’Assemblée plénière des évêques.Confiance dans les promesses du Christ.Nouvelle du salut annoncé aux hommes par Jésus.Bienveillance de Dieu pour les hommes.Récit allégorique servant à présenter un enseignement et à en faciliter la compréhension.Centre de la foi et de l’espérance chrétienne.Ensemble des règles fixant le déroulement d’un cérémonial.Signe visible de la présence et de l’action de Dieu.
1 Etude Harris Interactive pour Grazia. Enquête réalisée en ligne du 17 au 20 février 2012. Échantillon de 1787 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. 86% des Français envisagent d’avoir recours à l’euthanasie active s’ils étaient un jour atteint d’une maladie incurable entraînant des souffrances, dont 41% certainement et 44% probablement. Moins d’un Français sur dix (9%) indique alors qu’il ne demanderait pas au corps médical d’avoir recours à l’euthanasie en cas de maladie incurable entraînant des souffrances, dont 3% certainement pas.
Si on compare ce sondage avec celui d’août 2011 réalisé en ligne du 17 au 19 août 2011 par Harris pour VSD, auprès d’un échantillon de 1041 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, on note une évolution de 3 points en 1 an (83%).
Le sondage TNS-Sofres-Ministère de la Santé, réalisé du 23 octobre au 16 novembre 2012 sur un échantillon de
1000 personnes représentatives note que 56% des sondés souhaitent la possibilité de demander à ce que le médecin les fasse mourir en cas de situation de fin de vie insupportable.
2 Manifeste de Jacques Monod, Linus Pauling et George Paget Thomson publié dans Le Figaro le 1er juillet 1974. Il s’agissait de la traduction d’un manifeste publié dans The Humanist en juin 1974.
3 Dans le rapport remis au Président de la République le 18 décembre 2012 par la Commission de réflexion sur la fin de vie en France, dirigée par le Professeur Didier Sicard, p. 19, il est fait état des 58% des sondés qui envisagent de demander à leur médecin qu’il leur donne un produit leur permettant de mettre fin eux-mêmes à leurs jours (suicide assisté). Il est précisé que les convictions religieuses interviennent peu.
4 Sigmund Freud, « Actuelles sur la guerre et la mort », Œuvres complètes, t. XIII, Paris, PUF, 2005 (1915), p.145.
5 Cf. : Rapport de la Commission de réflexion sur la fin de vie dirigée par le Professeur Didier Sicard et présenté au Président de la République le 18 décembre 2012, Penser solidairement la fin de vie, p. 11.
6 Rapport de la Commission de réflexion sur la fin de vie dirigée par le Professeur Didier Sicard, op. cit, p. 29.
7 Hubert Doucet, « La contribution de la théologie au débat sur l’euthanasie », in Mélanges offerts à René Simon, Actualiser la Morale, R. Bélanger et S. Plourde (éds.), Paris, Cerf, 1992, p. 130.
8 Emmanuel KANT, Métaphysique des mœurs I. Fondation, introduction, AK IV, 429, Paris, Flammarion, coll. « GF-Flammarion » n° 715, 1994, p. 108
9 Discours d’ouverture de l’assemblée plénière des évêques de France le 5 novembre 2013 à Lourdes.
10 Les membres du Conseil Famille et Société sont : Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy, Mgr Gérard Coliche, évêque auxiliaire de Lille, Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, Mgr François Jacolin, évêque de Mende, Mgr Dominique Lebrun, évêque de Saint-Etienne, Mgr Armand Maillard, archevêque de Bourges, M. Jacques Arènes, psychologue, psychanalyste, Mme Monique Baujard, directrice du Service national Famille et Société, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, professeur de droit, Sr Geneviève Médevielle, professeur de théologie morale, Père Pierre-Yves Pecqueux, secrétaire général adjoint de la CEF, M. Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales de France.